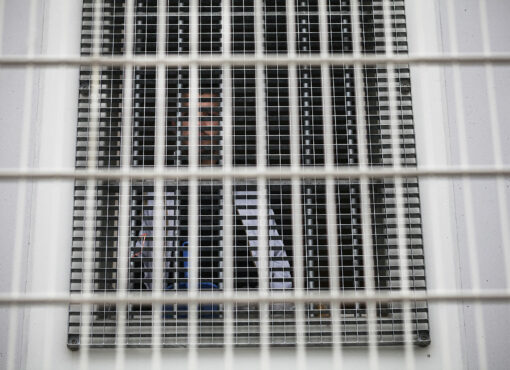Dès lors qu’une personne détenue est étiquetée « TIS » ou suspectée de se radicaliser, le niveau de surveillance dont elle fait l’objet est poussé à son cran maximum. Constamment évaluée, elle bascule dans un monde de suspicion permanente. Un traitement aux effets délétères sur les personnes détenues et une situation inconfortable pour les professionnels, sommés de se muer en auxiliaires du renseignement pénitentiaire.
Ses moindres faits et gestes consignés. Ses conversations, y compris privées, écoutées et rapportées. Sa correspondance et autres écrits, aussi personnels soient-ils, lus, copiés. Son matériel informatique régulièrement saisi, fouillé… À partir du moment où une personne détenue est étiquetée « TIS » (pour terroriste islamiste) ou « DCSR » (pour détenu de droit commun susceptible de radicalisation), son droit à la vie privée et à l’intimité – d’ordinaire déjà malmené en prison – devient chimère. La surveillance dont elle fait l’objet ne lui laisse plus aucun répit. Chacun de ses faits et gestes est épié et analysé en permanence, qu’elle se trouve en détention ordinaire, à l’isolement ou dans un quartier dédié. Dans les quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER, lire ici), elle est invitée – à travers une série d’entretiens – à se dévoiler, afin que son degré de « radicalité » et son potentiel prosélyte soient évalués. Observation et évaluation seraient aussi les principaux objectifs des quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR), pourtant censés être voués à l’accompagnement vers le « désengagement ». « L’observation s’exerce dans toutes les missions et actions du surveillant au sein du quartier », indique ainsi la doctrine d’emploi des QPR, qui précise : « le surveillant doit à tout moment être attentif » et utiliser ses « qualités d’écoute auprès des personnes détenues pour recueillir des informations ». « Réseau relationnel », « antécédents pénitentiaires », « habitudes », jusqu’à ses « préoccupations » : l’administration veut tout savoir de ces détenus. Toutes ces informations font l’objet de notes et de rapports plus ou moins occultes, dont il est, pour les personnes détenues, souvent impossible de connaître la teneur et la destination exactes. Une chose est en revanche à peu près sûre : ces dernières passeront toutes entre les mains du renseignement pénitentiaire.
Créé en 2016 par l’ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas, le Service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) ne cesse de voir ses moyens croître et sa présence s’étendre sur le terrain. Dans certains établissements, les commissions pluridisciplinaires uniques dédiées aux personnes identifiées comme radicalisées sont même présidées et animées par le délégué local du renseignement pénitentiaire : davantage qu’un « support de suivi et de prise en charge », ces CPU sont un « véritable outil de renseignement pénitentiaire »(1), constate le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL). Pour l’autorité de contrôle, « l’omniprésence » du renseignement agit comme un « facteur de déstabilisation des équipes qui s’interrogent sur son rôle », mais aussi – et peut-être surtout – sur le leur.
Les professionnels interrogés sont en effet nombreux à redouter d’être instrumentalisés et à craindre que les éléments d’information qu’ils pourraient divulguer lors de ces CPU soient déformés et utilisés à des fins qui les dépassent. « Ils veulent tout savoir. Moi, je pense qu’il faut poser des limites à ce que l’on peut rapporter. Or, on nous enjoint de tout dire », regrette ainsi un psychologue auprès du CGLPL. « Ils ont accès à nos synthèses s’ils les demandent, et à tout ce qui se trouve dans le dossier pénal. Ils sont là en CPU. Le problème, c’est que dans les établissements où j’ai travaillé, les agents de renseignement ne voient jamais les personnes dont on parle, explique Cécile, conseillère pénitentiaire d’insertion et de probation (CPIP) qui a travaillé en QER. Ils écoutent ce qui se dit et prennent les infos qui les intéressent. Sauf que même si vous dites plein de choses positives sur une personne, ils ne retiendront que l’information qui pourrait être interprétée comme quelque chose de négatif, dans le sens d’un passage à l’acte possible. Ils rentrent tout ça dans leur logiciel, et au final, ça ne donne pas quelque chose de très fidèle. » Le malaise est d’autant plus grand pour ces professionnels qu’ils ignorent qui a accès à ces informations et quel usage en sera fait.
La chasse aux dissimulateurs
Dans ce dispositif d’évaluation permanente, certains professionnels, « mis en situation d’interroger la sincérité des propos qui [leur] sont tenus », se sentent parfois réduits à « jouer le rôle de détecteur de mensonge »(2). Au centre des préoccupations : la taqiya, stratégie visant à dissimuler ses convictions et intentions djihadistes aux autorités. « On cherche à tout prix la dissimulation : c’est le grand mot des quartiers d’évaluation, explique Cécile. Le présupposé, c’est qu’il y a forcément quelque chose qui ne va pas chez la personne. Mais alors quoi ? Si on ne trouve pas, c’est que l’on est de mauvais évaluateurs. Au-delà de devoir évaluer, on a l’impression de devoir trouver ce qui cloche. » Au QPR aussi, « ils analysent tout : pour eux chaque changement est suspect, raconte Julien, qui a été incarcéré plusieurs mois dans celui de Condé-sur-Sarthe. Par exemple, il y avait deux ou trois mecs qui avaient les cheveux longs en arrivant, et presque au même moment, ils les ont coupés ou se sont rasé la tête, par goût enfin je ne sais pas mais ça n’avait rien de religieux… Un gradé en attrape un et lui dit “je vois que vous avez une trace de prière, vous priez beaucoup, vous vous êtes rasé les cheveux, vous vous habillez en blanc… Vous ne préparez pas quelque chose ?” C’est beaucoup de parano, de déductions erronées de la part de certains surveillant », estime-t-il. Inconfortable pour les équipes, cette chasse aux dissimulateurs est aussi déstabilisante pour les personnes détenues : « On en arrive à avoir des détenus totalement perdus, qui ne savent plus trop quoi dire. Ils se demandent comment ils doivent agir alors que l’idée serait de les amener à la spontanéité », déplore Cécile.
Feu de tout bois
Ce manque de spontanéité, c’est précisément ce qui a été reproché à l’un des clients de Me Pierre-François Feltesse. Évalué au QER d’Osny, celui-ci est ressorti avec un rapport « catastrophique », selon les mots de l’avocat : « Dans son évaluation, on a relevé qu’il prenait le temps de réfléchir, de faire des réponses appropriées. On en a conclu qu’il était dans la dissimulation et il s’est retrouvé en QPR, raconte-t-il. Mon client m’a dit : “J’encours une peine immense, vous pensez vraiment que je vais répondre du tac au tac ? J’ai peur que ce soit une mauvaise réponse, du coup, je réfléchis !” Ça paraît logique, et pourtant ça lui a été reproché. À partir du moment où on met un pied dans l’association de malfaiteurs terroriste, on est confronté à la supposition permanente du pire », conclut l’avocat. Un constat partagé par son confrère Matthieu Quinquis, dont l’un des clients se trouve depuis plusieurs années à l’isolement. « Sur le seul motif de son écrou, chacun de ses faits et gestes est appréhendé comme un signe soit de sa radicalisation, soit de son processus de dissimulation, soit de son prosélytisme », pointe l’avocat.
« S’ils se comportent mal ou s’ils donnent des signes de radicalisation, c’est qu’ils sont radicalisés. S’ils se comportent sans signe de “déviance” apparent, ce sont des dissimulateurs qu’il faut démasquer », résument les chercheurs Gilles Chantraine et David Scheer, qui ont enquêté dans des QER dans les premiers mois qui ont suivi leur ouverture. Dans leur rapport paru en 2018(3), un détenu fait part de son angoisse face à cette situation kafkaïenne : « Après un entretien, je ne dors pas, je repense à ce que j’ai répondu. (…) C’est les mêmes questions pour tout le monde. “Qu’est-ce que tu penses de Charlie Hebdo ?”, “Qu’est-ce que tu penses de l’homosexualité ?”, “Qu’est-ce que tu fais si ton codétenu veut commettre un attentat ?” Quand on y réfléchit, c’est n’importe quoi. Il n’y a jamais de bonnes réponses. Si tu dis un truc, ils te prennent pour un fou dangereux et si tu dis l’inverse, ils te disent que tu fais la taqiya. Il n’y a pas d’issue. On est piégé. » Que ce soit face aux évaluateurs ou dans leur vie quotidienne en détention, « ils commencent tous à comprendre que quoi qu’ils fassent, ils seront perçus comme potentiellement radicalisés… Donc ils sont de plus en plus sur le qui-vive, ce n’est bon pour personne. Ils ne peuvent pas cultiver une forme d’authenticité dans un système pareil », abonde l’avocate Marie Dosé, qui a plusieurs clients TIS.
Autre élément susceptible d’être retenu à charge : leurs fréquentations en détention. Or, dans ces quartiers exclusivement dédiés aux TIS et DCSR que sont les QER et QPR, ils n’ont pas d’autre choix que d’en fréquenter – sauf à rester cloîtrés en cellule. Une option prise par certains clients des avocats interrogés pour cette enquête, qui préfèrent s’imposer un isolement total plutôt que risquer de voir une banale conversation interprétée à leurs dépens. D’autres encore, en détention ordinaire, choisissent par exemple de ne plus fréquenter le culte.
Des conséquences parfois lourdes
Il faut dire que les notes blanches – non datées, non signées et non sourcées – peuvent servir aussi bien à étayer des décisions de placement à l’isolement qu’à venir justifier un refus d’aménagement de peine ou la mise en œuvre de mesures de sûreté à la sortie. « Dans les décisions d’assignation à résidence, on retrouve beaucoup d’extraits de notes blanches qui sont certainement basées – enfin on ne sait jamais précisément – sur des rapports pénitentiaires, avec des choses aussi banales que “avait des Corans dans sa cellule, un tapis de prière, prie cinq fois par jour et fait de la boxe en prison” », rapporte l’avocate Lucie Simon. Ces notes et rapports occultes, agrégats d’observations qui, mises bout à bout, sont censées éclairer sur la dangerosité présumée des personnes, ont donc potentiellement de lourdes conséquences sur le devenir des concernés, que ce soit en détention ou à la sortie. C’est ce que l’un des clients de Marie Dosé a pu constater à ses dépens. « Devant le juge de l’application des peines, il a appris qu’un rapport du renseignement disait qu’il était en lien avec X., qui serait très radicalisé. Sauf que mon client ne voyait pas qui il était ! En fait, il s’agissait d’un des détenus présents au QER en même temps que lui. Un jour, alors qu’ils étaient tous les deux en promenade, ils ont échangé quelques mots et cette conversation a été captée par les caméras. Et c’est donc sur le fondement de ce prétendu lien que le Parquet motivait son refus d’aménagement et l’“impérieuse nécessité” de le surveiller à sa sortie de prison. »
Or, si, en l’occurrence, le rapport du renseignement pénitentiaire a été porté au dossier par le magistrat, ce n’est pas toujours le cas. « Parfois, s’agissant des détenus soupçonnés de radicalisation, on nous donne l’information, tout en nous disant de la garder pour nous, confie un juge de l’application des peines (JAP). Pour moi ce n’est pas possible : si on me donne une information qui pèse sur ma décision, je dois la soumettre au principe du contradictoire. Mais cette question fait toujours débat parmi les collègues JAP… »
Pour les professionnels et avocats interrogés, ce climat de suspicion généralisée ne peut être que contre-productif. « C’est terrible car très franchement, on a le sentiment que ça précipite le passage à l’acte ou la récidive, se désole Cécile. Chez certains, c’est l’impression de n’appartenir à rien, d’être rejetés d’un système qui les a fait tomber dans la radicalisation. Ce sont des gens qui, à la base, sont complotistes, donc là leur théorie du complot est alimentée. » « Certains de mes clients sont restés sous le choc du rapport QER, et n’ont plus confiance en personne : ils ont été authentiques, n’ont pas voulu tricher, et la lecture du rapport les a anéantis, abonde Me Marie Dosé. Après cela, ils ont arrêté les suivis psy, ils ne veulent plus rien investir en détention : ils ont senti la culture du renseignement et de l’accusation et n’ont plus confiance en quoi que ce soit. Et ça, c’est catastrophique. À part alimenter leur délire de persécution, je ne vois pas en quoi ça peut nous servir. »
Par Laure Anelli
(1) CGLPL, « Prise en charge pénitentiaire des personnes “radicalisées” et respect des droits fondamentaux », janvier 2020.
(2) Ibid.
(3) G. Chantraine (dir.), D. Scheer, M.-A. Depuiset, « Enquête sociologique sur les “quartiers d’évaluation de la radicalisation” dans les prisons françaises », avril 2018.