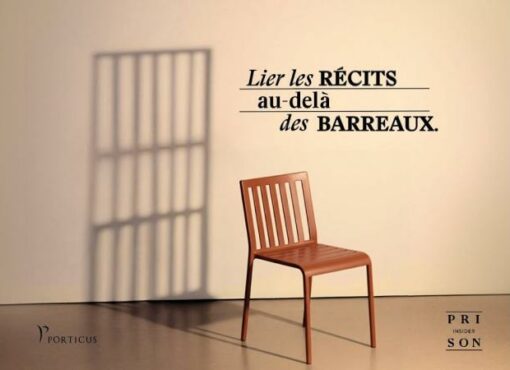« Le maintien des liens familiaux, condition fondamentale de la réinsertion des personnes placées sous main de justice et de la prévention de la récidive, est une des principales missions de l’administration pénitentiaire », affirme le ministère de la Justice. Et pourtant, ce droit fondamental est quotidiennement malmené. Des deux côtés des murs, les obstacles à surmonter sont nombreux.
« On est en prison aussi. On ne vit plus. On s’inquiète pour eux. Le moindre plaisir, on culpabilise : la viande, elle ne passe plus parce que je sais qu’il ne peut pas en manger dedans. » « Le plus dur à vivre, ce sont les moments que je voudrais passer avec elle, alors que c’est impossible. Cette année, j’ai décidé de travailler pendant les fêtes, pour ne pas y penser, et aussi parce que c’est très dur de faire des choses qui me feraient plaisir quand je sais qu’elle est enfermée entre quatre murs. Alors j’ai décidé de ne rien faire le 25 décembre, de juste prendre deux jours pour préparer son colis de Noël, cuisiner les plats qu’elle aime. » Au-delà de la souffrance de la séparation forcée, de l’absence imposée, de la culpabilité de vivre libres quand celui ou celle qu’elles chérissent est enfermé, ces mères de personnes détenues disent les vies bouleversées, réorganisées autour de la prison. « Au point d’avoir le sentiment d’être également enfermées »(1) – victimes collatérales d’une peine qui ne leur était pas destinée.
Les coûts de la détention sont élevés, pour ceux qui attendent dehors. Financièrement d’abord : 62 % des personnes interrogées par l’Uframa(2) dans sa dernière enquête(3) déclarent s’être appauvries avec l’incarcération de leur proche et la perte de son revenu. Alors même que celle-ci occasionne des frais supplémentaires. Produits d’hygiène, télévision, téléphone… Tout se paye en prison, et à des prix souvent supérieurs à ceux pratiqués à l’extérieur. Faute de travail et de salaire décent à l’intérieur, les proches mettent souvent la main à la poche. « On se prive pour eux : j’envoie des mandats de 250 € pour qu’il ne soit pas obligé de demander aux autres, de montrer des signes de faiblesse », confie cette mère. L’incarcération a aussi un coût en termes de temps pour les proches, qui doivent parfois assumer des démarches administratives supplémentaires, prendre en charge des tâches domestiques et logistiques autrefois partagées. Sans compter le temps à dégager pour se rendre au parloir. Des heures accumulées qui, « en saturant le temps des proches, participe[nt] au risque d’effritement de leurs relations »(4) amicales ou familiales. Et le prix à payer devient aussi social.
Autant de coûts démultipliés par les distances parfois faramineuses que les personnes doivent parcourir pour rendre visite à leur proche détenu. D’après l’enquête réalisée par l’Uframa, près d’une personne sur quatre réside à plus de 100 kilomètres de la prison dans laquelle son proche est incarcéré. Fatigue, stress, usure… Ces déplacements contraints pèsent à la longue tant sur le corps que sur le mental. « Plus les mois passaient, plus j’étais à bout, physiquement, mentalement, psychologiquement. Je pleurais, je n’avais plus envie de travailler, de m’occuper de mon enfant », témoigne une compagne. Si bien que les visites, qui « devraient être une joie », deviennent un « poids ». Il faut dire que les conditions dans lesquelles elles se déroulent généralement sont loin d’en atténuer la charge.
Les visites au parloir : un plaisir autant qu’une souffrance
D’après la loi pénitentiaire de 2009, toute personne détenue peut bénéficier d’au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou, à défaut, dans un parloir familial(5). Sauf que dix ans après, plus des deux tiers des prisons en sont encore dépourvues – à commencer par les maisons d’arrêt. Et même quand elles sont bel et bien construites, à portée de main, les UVF restent parfois inaccessibles : faute d’effectifs suffisants dans les établissements, « c’est le premier poste qui saute », déplore Damien Pellen, représentant du Syndicat national des directeurs pénitentiaires. Priorité à la sécurité, le maintien des liens attendra. La plupart des visites ont donc lieu au parloir, dans des conditions souvent difficiles.
La prison, dès qu’elle semble donner quelque chose, c’est repris, cassé immédiatement.
Passée l’épreuve de l’obtention du permis, puis celle de la réservation d’un créneau ; passée l’attente interminable qui succède au stress d’arriver en retard – cinq minutes peuvent parfois suffire à annuler la visite, il faut encore franchir les contrôles. Les visiteurs sont alors confrontés à une multitude de règles et d’interdits, souvent perçus comme arbitraires tant ils varient d’une prison à l’autre, d’un surveillant à l’autre, d’un jour à l’autre. Parmi les interdictions, l’une suscite particulièrement l’incompréhension : celle d’apporter de la nourriture, quand cela permettrait d’améliorer le quotidien à l’intérieur et de restaurer un moment de plaisir perdu avec leur proche. Alors certains n’hésitent pas à la contourner, au risque de voir leur droit de visite supprimé. Les contrôles dépassés, la rencontre peut enfin avoir lieu. Mais, là encore, dans quelles conditions ? Locaux insalubres, cabines exiguës à l’hygiène plus que douteuse, parloirs collectifs sans cloison ni isolation phonique… Sous la surveillance d’agents parfois zélés, il faut pourtant profiter : les précieuses minutes sont comptées – entre trente et quarante-cinq le plus souvent en maison d’arrêt. « On sort de la visite sans avoir pu communiquer. Tout le monde a été gêné par les conversations des autres, il n’y a aucun échange », regrette une mère.
« Après la joie des retrouvailles », vient « la souffrance de la séparation », des deux côtés du mur. Dont la violence est renforcée par l’institution. « Quand on est dans la salle d’attente, on sait pourquoi on attend : après chaque parloir, ma fille subit une fouille à nu. C’est ce qui me rend le plus malade. Même si elle n’en parle pas, je suis convaincue que c’est très dur pour elle. À chaque sortie de visite, elle est reprise en main par l’institution et se retrouve de nouveau plongée dans ce que la détention a de plus dur. La prison, dès qu’elle semble donner quelque chose, c’est repris, cassé immédiatement. »
Une intimité impossible, des échanges empêchés
Des années de parloir dans de telles conditions, cela use. « Petit à petit, on reçoit moins de visites. Après des années en maison d’arrêt, tu te retrouves en maison centrale. Les conditions de visites sont bien meilleures. Sauf qu’il n’y a plus personne pour te rendre visite. » De fait, seulement un quart des condamnés à une peine de plus de cinq ans ont une visite hebdomadaire(6). Hormis les parloirs, il y a bien le téléphone. Mais les appels sont surtaxés et les points phone accessibles sur des plages horaires restreintes – généralement aux heures où le conjoint est au travail, les enfants à l’école – et souvent situés dans des lieux de passage : dans la cour de promenade, une coursive… Pour l’intimité, on repassera. D’autant plus que les conversations peuvent être écoutées et enregistrées. Reste le courrier. Mais là encore, les mots peuvent être lus, les échanges, surveillés. Alors « on gomme la vérité des mots, la profondeur des sentiments », témoigne encore cet ex-détenu.
Des deux côtés des murs, la position est presque intenable. Alors il arrive que les uns et les autres abandonnent.
Que ce soit au parloir ou par téléphone, et au-delà même des écoutes, chacun revêt un masque. « Des deux côtés, on se contrôle en permanence. On se préserve mutuellement », confie une mère. « Ils ne vous disent pas si ça ne va pas, ce qu’il se passe dedans. Ils ne veulent pas vous inquiéter, rapporte une autre. Et inversement : ils ne voient pas qu’on souffre, qu’on est fatigué. Tout ça, il ne faut pas leur dire. Parce que la moindre parole, vous savez qu’ils vont la cogiter pendant une semaine. Par exemple, il a perdu sa grand-mère récemment. Ça a été horrible : comment lui annoncer ? » Au-delà du choix des mots, se dresse un obstacle de taille : comment avertir son proche lorsque qu’il est impossible de le joindre ? Sans portable à l’intérieur, il faut attendre les horaires d’ouverture des bureaux ; que quelqu’un décroche au bout du fil ; que l’information soit effectivement transmise. Alors il arrive que la nouvelle se perde en route, aussi essentielle soit-elle. Quand elle parvient, c’est aussi la solitude, l’impossibilité de vivre son chagrin avec ceux qui le partagent. Et bien que, en théorie, les personnes détenues doivent pouvoir se rendre aux obsèques, il arrive fréquemment qu’elles en soient empêchées, faute de moyens d’escorte. Ce qui est vrai pour les moments tristes l’est aussi pour les moments heureux. Être détenu, c’est par exemple ne pas pouvoir assister à la naissance de son enfant. Une absence qui symbolise à elle seule les nombreuses entraves à la parentalité en prison : juridiques, matérielles, affectives… Des deux côtés des murs, la position est presque intenable. Dehors, c’est porter le poids de l’absence au quotidien comme dans les moments importants, mais aussi la responsabilité du maintien de la relation. Dedans, c’est être dépendant de l’institution et du bon vouloir de ses proches à maintenir le lien. Réduits à la passivité, à se sentir spectateur de leur vie. Alors il arrive que les uns et les autres abandonnent. Des deux côtés des murs.
Par Laure Anelli
(1) G. Bouchard, D. Lapeyronnie, « Prisons et transitions familiales », étude réalisée en 2005 pour l’Uframa.
(2) Union des fédérations régionales des associations de maisons d’accueil des familles et proches de personnes incarcérées.
(3) « À propos du vécu des familles et des proches de personnes incarcérées », résultats de l’enquête menée par l’Uframa entre septembre et décembre 2017, publiée en novembre 2018.
(4) Caroline Touraut, « Entre détenu figé et proches en mouvement. “L’expérience carcérale élargie” : une épreuve de mobilité », Recherches familiales, 2009/1 (n° 6).
(5) Salons fermés de 12 à 15 m², réservables pour des durées de six heures maximum en journée.
(6) Aline Désesquelles, Annie Kensey, « Les détenus et leur famille : des liens presque toujours maintenus mais parfois très distendus », Insee, 2006.