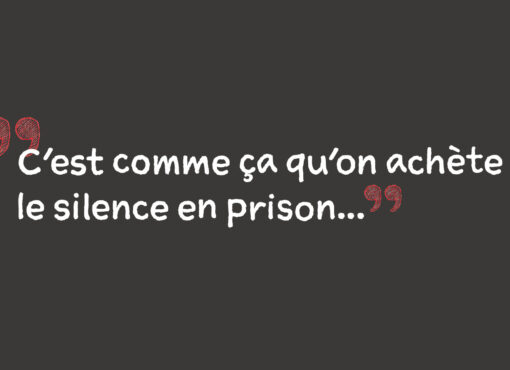Dans son volet « prévention de la récidive », le projet de loi sur l’exécution des peines ne prévoit pas de moyens supplémentaires pour les SPIP et se contente d’annoncer la généralisation déjà prévue de dispositifs en cours : diagnostic à visée criminologique et programmes de prévention de la récidive. Il renforce encore le poids que la justice pénale fait peser sur les psychiatres, sollicités pour lui désigner les détenus les plus « dangereux » et ceux qui ne respecteraient pas leur injonction de soins.
Afin de « mieux évaluer le profil des personnes condamnées », l’annexe du projet de loi annonce une série de mesures venant confirmer la confusion régnant entre diagnostic criminologique, évaluation de la « dangerosité » et expertise psychiatrique, ainsi que le peu de cas accordé au secret professionnel des soignants ou des personnels d’insertion et de probation.
« Diagnostic à visée criminologique »
Le projet de loi annonce une nouvelle fois la généralisation du « diagnostic à visée criminologique » (DAVC), grille d’entretien commune à tous les conseillers d’insertion et de probation (CPIP). Après une longue gestation, elle était déjà planifiée pour le 1er mars 2012 selon une circulaire de la DAP du 8 novembre 20111. Rappelons que ce document comporte cinq parties : situation pénale/respect des obligations ; rapport à la condamnation/l’acte ; situation personnelle et familiale ; situation médicale ; parcours d’exécution de la peine. Les questions posées rassemblent celles que la plupart des CPIP examinaient déjà avec la personne au cours de leurs premiers entretiens, avec l’avantage d’intégrer des éléments parfois négligés, tels que les « leviers et ressources de la personne », à savoir les facteurs favorables à une insertion et une sortie de délinquance sur lesquels la personne peut s’appuyer.
En revanche, le DAVC ne peut aucunement prétendre constituer un outil « se conformant aux règles européennes de probation (REP) » comme l’affirme la circulation d’application de la DAP. Le Conseil de l’Europe se réfère en effet à des outils d’évaluation conçus sur la base de la recherche anglo-saxonne, qui font porter le diagnostic sur « les risques, les facteurs positifs et les besoins, les interventions nécessaires pour répondre à ces besoins ainsi qu’une appréciation de la réceptivité de l’auteur d’infraction à ces interventions »2. Une recherche méconnue en France, qui n’a pas été intégrée dans la phase d’élaboration du DAVC, conçu uniquement sur la base des pratiques existantes en France. Simple grille d’entretien, le DAVC ne constitue pas un outil d’évaluation des facteurs de risques/besoins/réceptivité. Le CPIP qui le remplit n’est pas même aiguillé quant aux conclusions à tirer de tel ou tel type de réponse. En ce sens, le DAVC ne fait que formaliser des pratiques actuelles et il ne peut en être attendu d’évolution majeure en termes d’évaluation des problématiques des personnes en lien avec leur passage à l’acte.
Autre divergence fondamentale avec les règles européennes: le DAVC ne réserve pas d’espace au recueil de l’avis du détenu ou du probationnaire. Les REP insistent pourtant sur la nécessité de leur participation active à cette « appréciation formelle, ce qui implique notamment que leurs avis et souhaits personnels soient dûment pris en compte »3. Cette approche de co-élaboration du diagnostic, résultant d’un échange de vues, les points de désaccords étant inscrits dans le document, est sauf exception inexistante au sein l’administration pénitentiaire française, qui ne forme pas ses professionnels en ce sens. Les REP indiquent également que les personnes suivies doivent « être informées de la procédure et des conclusions de l’appréciation ». La circulaire rappelle pour sa part le droit d’accès et de rectification des personnes à leurs données personnelles figurant dans le DAVC, qu’elles peuvent « exercer en saisissant le procureur de la République ». Pour le Conseil de l’Europe, ce droit implique une remise directe et systématique du document à la personne.
Le projet de loi de programmation confirme enfin le problème majeur de confidentialité entourant cet outil dès sa mise en ligne informatique. Il indique en effet que « les données du DAVC seront intégrées dans Cassiopée. À ce titre, elles seront utilisables par les parquets et les services d’application des peines ». Il est par ailleurs indiqué que « l’application Cassiopée sera interfacée avec les services de police et de gendarmerie en 2013 »4. Comme l’indiquent des personnels des SPIP dans le cadre d’une étude sur la probation, « une telle option entre en contradiction avec les exigences du secret professionnel, qui s’imposent notamment dans l’optique d’instaurer une relation de confiance. A défaut, il sera difficile d’entreprendre un accompagnement sur des questions souvent sensibles liées au passage à l’acte délinquant. Le risque d’utilisation de ces données à d’autres fins que celle de l’évaluation et de l’élaboration d’un plan de suivi réduira nécessairement l’expression autant du probationnaire que du professionnel dans le cadre du DAVC. »5
Il est même probable que nombre de personnels refusent dès lors de renseigner ce document, comme leurs organisations syndicales les y encouragent d’ores-et-déjà. Le syndicat SNEPAP a ainsi renouvelé son « appel au boycott du DAVC ». Il considère que « la seule visibilité par les autorités judiciaires du Siège et du Parquet sur les hypothèses de travail des personnels d’insertion et de probation et les conséquences qui peuvent en découler pour la situation pénale des personnes sous main de justice, suffisent à disqualifier un outil qui ne sert désormais plus que la communication institutionnelle de la DAP et du ministère.»6 Enfin, la création annoncée dans l’annexe du projet de loi de « 103 emplois de psychologue pour la mise en œuvre de cette mesure » laisse perplexe, le DAVC n’étant rempli que par les personnels d’insertion et de probation.
Centres nationaux d’évaluation
La confusion des genres est encore de mise avec l’annonce de trois nouveaux centres nationaux d’évaluation, dans lesquels devront passer pour quelques semaines les détenus « condamnés à une longue peine, qui présentent un degré de dangerosité a priori supérieur ». Si l’approche pluridisciplinaire apparaît judicieuse, le seul diagnostic clinique des psychiatres n’intégrant pas les dimensions liées au milieu de vie et au contexte relationnel, ce type d’évaluation apparaît d’emblée mal engagé en France, les pouvoirs publics se fondant sur une notion de « dangerosité » dénuée de fondement scientifique. Dans les pays qui pratiquent des expertises criminologiques alliant observations cliniques et outils d’évaluation, personne ne prétend plus mesurer la « dangerosité » d’une personne, mais les « facteurs de risque » de commission d’une nouvelle infraction, auxquels elle est exposée à un instant T : ces facteurs relèvent aussi bien de sa situation sociale (absence d’activité, isolement, relations cantonnées au milieu délinquant…) que de son rapport personnel à la loi et aux limites (croyances de ne pas pouvoir agir autrement, que l’acte délinquant est justifié, etc.). L’évaluation des facteurs de risque se distingue d’une évaluation de la « dangerosité », impossible à réaliser et relevant d’une conception erronée selon laquelle un individu pourrait être intrinsèquement « à risque ». Plutôt que de servir à décider de mesures de sûreté ou d’aménagements de peine, ces évaluations gagnent en outre à être utilisées pour mieux cibler l’accompagnement des personnes sur leurs besoins.
Le Conseil de l’Europe indique que « l’expérience de l’apprentissage au sein d’un groupe de personnes vivant la même situation peut être très efficace »
Les soignants sous le joug judiciaire
Toujours dans une optique de prévention de la récidive, l’article 5 du projet de loi vise à imposer aux soignants en milieu fermé, de délivrer au détenu soumis à une injonction de soins, ainsi qu’au juge de l’application des peines « des attestations indiquant si le patient suit ou non de façon régulière le traitement proposé par le juge de l’application des peines ». Cette disposition déjà en œuvre en milieu ouvert – où un médecin coordonnateur fait néanmoins l’interface entre le médecin traitant et le juge – ne manquera pas de susciter des inquiétudes. Passons outre la formulation d’un « traitement proposé par le JAP », comme s’il était désormais acquis qu’un magistrat ait compétence à prescrire un traitement… L’article 5 dispose que la remise d’attestations au JAP a pour objectif de lui permettre de se prononcer sur « le retrait des réductions de peine, l’octroi de réductions de peine supplémentaires ou l’octroi d’une libération conditionnelle ». Est ainsi encore renforcé un détournement des soins à des fins de décision judiciaire, incitant la personne détenue à se conformer en apparence à la thérapie, sachant qu’en dépendront des décisions relatives à sa privation de liberté. Le professionnel doit-il attester uniquement du fait que le détenu se présente aux rendez-vous, ou signifier si la thérapie est purement formelle ou réelle, voire si elle est « efficace », et selon quels critères ? Selon l’étude d’impact, le magistrat pourra grâce à cette disposition, « se prononcer, en toute connaissance de la réalité du suivi de soins, sur le retrait ou l’octroi de réductions de peines ou le prononcé d’un aménagement de peines. Le contrôle de la réalité de la démarche de réinsertion par le détenu en sera renforcé. » Une naïveté ayant pour conséquence de risquer d’éloigner encore un peu plus les personnes détenues de la rencontre avec des soignants dont elles ont parfois tant besoin.
Des programmes de prévention de la récidive sans moyens
Sur le contenu de l’accompagnement assuré par les SPIP, l’annexe du projet de loi annonce que « les programmes de prévention de la récidive [PPR] seront généralisés à tous les établissements pénitentiaires, et incluront obligatoirement un volet spécifique relatif à la délinquance sexuelle. Ces programmes seront élaborés et mis en œuvre par une équipe interdisciplinaire, comprenant notamment des psychologues. » En premier lieu, il convient de rappeler que les PPR, groupes de paroles développés par de nombreux SPIP depuis 2007, ne concernent pas que les établissements pénitentiaires, mais aussi et surtout le milieu ouvert, plus propice à la réalisation de telles actions. En second lieu, ils ne peuvent tous inclure un volet relatif à la délinquance sexuelle, puisque chaque programme porte sur un type d’infraction, celui pour lequel la personne a été condamnée : parmi les 156 PPR comptabilisés n 2010, 32 % portaient sur les violences à caractère sexuel, 30 % sur les violences familiales et conjugales, 14 % sur les violences, 10 % sur les délits routiers…7 Quant à l’élaboration et la mise en œuvre par une équipe pluridisciplinaire, seuls les CPIP peuvent animer ces groupes de parole, le psychologue n’intervenant que pour superviser les professionnels en dehors des séances. Ces programmes ont l’avantage d’introduire en France le travail de groupe, alors que le Conseil de l’Europe indique que « l’expérience de l’apprentissage au sein d’un groupe de personnes vivant la même situation peut être très efficace » 8. La manière dont ils sont développés en France reste néanmoins artisanale, les professionnels des SPIP étant chargés d’en élaborer eux-mêmes le contenu, alors que les programmes de même nature développés dans d’autres pays sont élaborés et évalués par des chercheurs ; les professionnels chargés de les animer suivent une véritable formation et une méthode éprouvée qui fait pour l’instant défaut en France.
Pour développer de tels programmes, les SPIP auraient également besoin de davantage de moyens. Or, le projet de loi de programmation ne prévoit la création que de 88 emplois de CPIP « mobiles », « pour renforcer les SPIP en cas de pic d’activités ». Cette annonce pourrait faire sourire, si on ignorait la situation dramatique de nombre de ces services. Pour justifier le maintien du nombre d’emplois de CPIP à son niveau actuel, le Gouvernement s’appuie sur un rapport des inspections des finances et des services judiciaires de juillet 2011 ayant estimé que « le niveau actuel des effectifs de personnel d’insertion et de probation apparaît globalement adapté ». Pour parvenir à cet invraisemblable résultat, les inspections ont tablé sur un effectif de référence correspondant à 82 personnes suivies par CPIP. Lorsqu’on prétend lutter contre la récidive, développer les PPR et autres méthodes d’accompagnement… ce sont des ratios de 25 (comme en Suède) à 40 (comme au Canada) personnes à suivre par conseiller qu’il faut nécessairement viser, et non maintenir ceux de 80 en moyenne, avec des pics de 150-200 dans certaines périodes. Le Gouvernement ne prévoit que de répondre à ces pics conjoncturels à travers la mise en place d’équipes mobiles. Concrètement, cela signifie que des CPIP arriveront dans un service pour une courte période, au cours de laquelle ils rencontreront des personnes condamnées dont ils n’assureront pas le suivi jusqu’à son terme, le tout en l’absence de connaissance du territoire et du réseau de partenaires locaux chargés de compléter le suivi du SPIP en matière d’insertion et de soins… Vous avez dit prévention de la récidive ?
Sarah Dindo
1. DAP, circulaire relative au DAVC, 8 nov. 2011.
2. Règle 66, Recommandation Rec(2010) sur les Règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation, 20 janvier 2010.
3. Règles 67 et 68, Recommandation CM/Rec(2010) sur les Règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation, 20 janv. 2010.
4. Annexe du projet de loi, op.cit., 23 nov. 2011.
5. S. Dindo, « SME : la peine méconnue – une analyse des pratiques de probation en France », DAP/PMJ1, mai 2011.
6. Snepap, « Circulaire DAVC : il n’est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir », 15 nov. 2011.
7. S. Dindo, op.cit., DAP/PMJ1, mai 2011.
8. Commentaire relatif à la Règle 77 de la Recommandation CM/Rec(2010) sur les Règles du Conseil de l’Europe relatives à la probation, 20 janv. 2010.