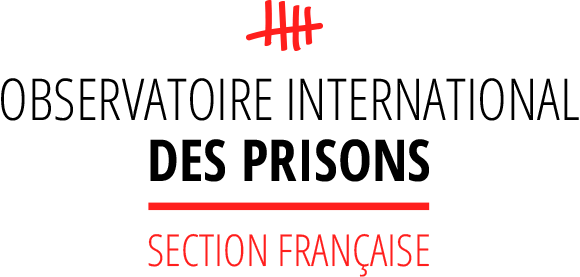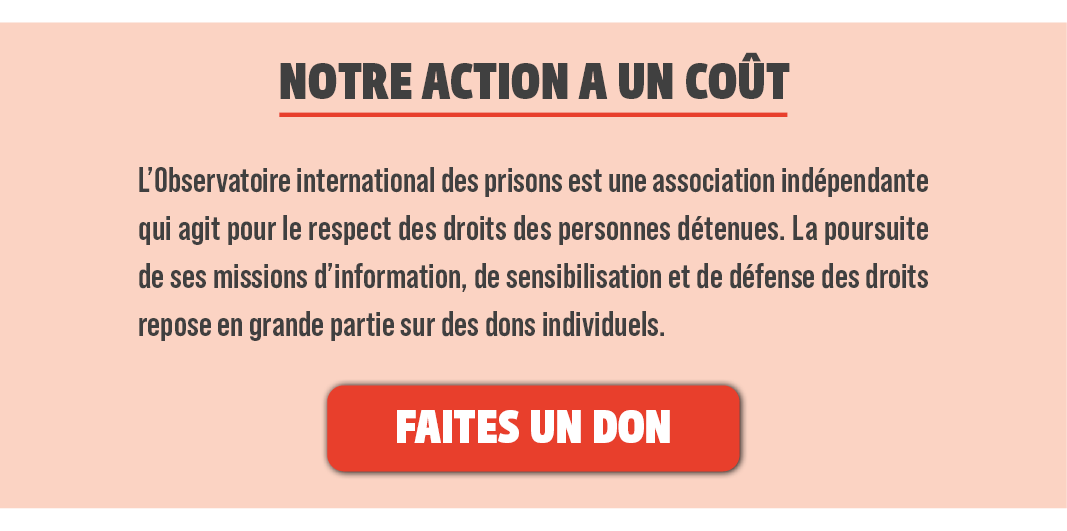La nouvelle loi « Immigration » ouvre toutes les vannes à l’expulsion des personnes étrangères condamnées ou simplement mises en cause dans une affaire judiciaire. Élevée en rouage central de la réponse pénale, la « double peine » s’ancre encore davantage dans le paysage institutionnel – au mépris des principes les plus élémentaires, à commencer par le droit à la réinsertion.
Promulguée le 26 janvier 2024, la loi dite « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » s’inscrit dans le droit fil d’une politique gouvernementale particulièrement hostile aux personnes étrangères, à commencer par celles qui ont affaire de près ou de loin à la justice pénale. Mais si de nombreux signes avant-coureurs le laissaient entrevoir – notamment une accumulation d’instructions ministérielles prises depuis l’élection d’Emmanuel Macron[1] –, nul n’aurait pu croire que le texte prendrait une telle coloration répressive. Épousant les revendications les plus réactionnaires, cette loi renforce considérablement la « double peine » et achève de brouiller les frontières entre les pouvoirs judiciaire et administratif[2]. Une confusion qui, loin d’être naïve, traduit un véritable projet politique réservé aux étrangers auteurs d’infractions ou suspectés de l’être : favoriser leur expulsion au détriment de tout droit à la réinsertion.
La sidération porte également sur la méthode. Après une suspension de plus de six mois, l’examen du texte s’est en effet tenu à un rythme si cadencé que les juristes spécialisés peinaient eux-mêmes à suivre les évolutions proposées. Outre la complexité des dispositions législatives, les allers-retours frénétiques entre l’Assemblée nationale et le Sénat donnaient le tournis. Même s’il en a rejeté certains, le gouvernement a pleinement pris part à la course aux amendements xénophobes avec les partis les plus à droite de l’échiquier politique. Pour finir, la commission mixte paritaire, réunie lorsque les deux chambres ne parviennent pas à trouver un accord, a adopté, en une nuit et sans véritable débat démocratique, un texte qui pousse à leur paroxysme la stigmatisation, la criminalisation et la répression des personnes étrangères.
La banalisation d’un traitement discriminatoire
En dépit d’une forte mobilisation d’universitaires, d’associations – dont l’OIP – et de syndicats[3], le Conseil constitutionnel n’a censuré aucune des dispositions renforçant la double peine. Pourtant, l’idée qu’une personne étrangère puisse se voir infliger, du seul fait de sa nationalité, une sanction supplémentaire à la sanction pénale, et qu’elle soit expulsée voire bannie du territoire français à l’issue de sa peine, constitue une discrimination majeure.
Ces atteintes aux droits fondamentaux sont banalisées au nom d’une menace en puissance dont il faudrait se protéger. Les travaux de recherche[4] montrent pourtant que la « délinquance » des personnes étrangères n’a rien d’endémique et qu’elle est principalement la conséquence de leur plus forte précarité socio-économique. La nouvelle loi est d’ailleurs loin de ne concerner que les « étrangers auteurs d’actes de délinquance extrêmement graves », comme l’annonçait le ministre de l’Intérieur[5]. Bien au-delà des quelques 466 personnes étrangères condamnées pour un crime en 2022, ses dispositions relatives à la double peine concernent en réalité la quasi-totalité de celles qui sont condamnées, essentiellement pour des délits[6].
L’extension du périmètre de l’OQTF
La loi « Immigration » permet tout d’abord aux préfets de fragiliser encore davantage la situation administrative des personnes aux prises avec la justice pénale, qu’elles soient incarcérées ou non. En effet, un titre de séjour peut désormais être refusé ou non renouvelé, voire dans certains cas retiré, à toute personne étrangère « ayant commis les faits qui l’exposent à » une condamnation pour certaines infractions[7]. Parmi elles : faux et usage de faux, trafic de stupéfiants, vol dans les transports en commun, etc. Inutile que l’infraction soit reconnue comme telle par une juridiction pénale : seuls comptent les éléments matériels qui permettent d’en supposer l’existence.
Cette violente charge contre les principes les plus élémentaires du droit pénal intervient dans un contexte où la situation irrégulière des étrangers détenus résulte déjà, bien souvent, de leurs innombrables difficultés à obtenir ou faire renouveler un titre de séjour depuis la prison[8]. Une impasse qui offre toute latitude aux préfets pour notifier massivement aux personnes étrangères en fin de peine des obligations de quitter le territoire français (OQTF) « sans délai de départ volontaire », c’est-à-dire avec 48 heures pour saisir le juge au lieu de 30 jours. Une entorse au droit à un recours effectif que tout concourt à accentuer : les notifications sont bien souvent remises sans interprète, à la veille d’un week-end, sans que les personnes puissent consulter un avocat ou un dispositif d’accès au droit[9]. Cette pratique, déjà exponentielle ces dernières années, risque encore de se renforcer.
Il faut rappeler, pour le comprendre, que les OQTF notifiées en détention se fondent sur l’existence supposée d’une « menace pour l’ordre public » que constituerait la présence de la personne étrangère en France. Cette notion, dénuée de définition juridique et laissée à la libre appréciation des préfets, a de longue date été mobilisée de façon stéréotypée pour tous types d’infractions – et ce malgré une jurisprudence établie selon laquelle l’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir une menace à l’ordre public[10]. En témoigne, par exemple, l’OQTF récemment notifiée à un ressortissant bangladais à la suite de sa condamnation à un mois de prison avec sursis pour vente à la sauvette et à une amende pour conduite sans permis. Cette possibilité est même ouverte en l’absence de condamnation pénale, les services de l’État pouvant s’appuyer sur d’autres éléments tels que ceux figurant au « Traitement d’antécédents judiciaires » (TAJ), fichier qui recense l’intégralité des personnes mises en cause devant la justice pénale – y compris si elles ont été acquittées ou relaxées.
La loi « Immigration » pousse cette logique un cran plus loin. Elle réduit en effet comme peau de chagrin les catégories de personnes étrangères jusque-là encore tant bien que mal protégées contre une OQTF. Un parent d’enfants français, une personne entrée en France avant treize ans ou encore gravement malade, parmi bien d’autres exemples, peut désormais faire l’objet d’une telle mesure – ce que des garanties empêchaient depuis plus de trente ans. Après l’entrée en vigueur de la loi, un homme détenu arrivé en France à l’âge de trois ans s’est ainsi vu délivrer une OQTF, bien que ses parents et ses frères et sœurs aient obtenu la nationalité française, que sa conjointe soit française et qu’il soit lui-même père de trois enfants français, sur qui il exerce toujours son autorité parentale.
L’individualisation de la peine reléguée au second plan
Cette même logique s’applique aux arrêtés d’expulsion : une personne résidant régulièrement en France depuis plus de vingt ans, par exemple, peut désormais en faire l’objet si elle a été condamnée à quatre mois de prison pour vol. En effet, pour perdre le bénéfice d’une protection « relative[11] » contre un arrêté d’expulsion, une personne étrangère devait jusque-là être condamnée à au moins cinq ans de prison ; il suffit aujourd’hui qu’elle le soit pour une infraction punissable d’au moins trois ans d’emprisonnement[12]. Les personnes en situation irrégulière, quant à elles, perdent radicalement toute protection contre l’arrêté d’expulsion. Et les personnes condamnées à une interdiction du territoire français (ITF), pour leur part, perdent toute protection en cas de délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement, quelle que soit l’étendue de leur vie privée et familiale en France[13]
L’évolution normative est subtile, mais les conséquences dramatiques. D’une part, la peine prononcée par le juge au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale, s’efface au profit de celle encourue, prévue par le législateur. D’autre part, l’écart entre les peines prononcées et encourues est massif en matière délictuelle[14]. En 2022, 962 personnes étrangères étaient condamnées à une peine d’au moins cinq ans d’emprisonnement, quand environ 30 000 l’étaient pour des infractions punissables d’une telle peine[15].
ITF généralisée et libération-expulsion, la double peine assumée
Pour couronner le tout, deux autres aggravations portant sur l’ITF renforcent l’ancrage décomplexé de la double peine dans la loi française. Jusque-là réservée à certains types de délits, l’interdiction du territoire peut désormais être prononcée par le juge pour toute infraction punissable d’au moins trois ans d’emprisonnement, comme par exemple le vol. Ce qui élargit drastiquement le champ des personnes concernées, sans aucune considération pour la gravité des faits. La durée de l’interdiction, quant à elle, n’est plus calculée à partir de la sortie de prison, mais à partir de la sortie du territoire français – ce qui la rend potentiellement illimitée.
Entre atteinte à l’individualisation de la peine et primauté de l’expulsion sur la resocialisation, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin ne pouvait être plus clair : « L’aménagement de peine n’est possible que pour les Français qui, sortant de prison, veulent ou doivent se réintégrer à la société française. Ce qui n’est pas la vocation de l’étranger, qui lui doit quitter le territoire[16]. » Actant cette logique, la loi prévoit que les personnes détenues étrangères condamnées après son entrée en vigueur ne pourront plus faire l’objet d’une libération sous contrainte de plein droit que si elles font l’objet d’une mesure d’expulsion, immédiatement exécutée.
Des dispositions et des propos qui, mis en perspective avec ceux que tenait vingt ans plus tôt Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, illustrent le déplacement de l’idéologie xénophobe sur l’échiquier politique : « Ce n’est pas parce qu’une personne n’a pas la nationalité française […] que ses chances de réinsertion doivent être à jamais compromises et que sa famille doit être punie avec elle. Un même délit doit entraîner une même peine pour tous, ni plus ni moins[17]. »
Lors des débats parlementaires sur la loi « Immigration », le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, Sacha Houlié, assenait quant à lui : « Le texte comporte des mesures en matière de fermeté, et je suis curieux de savoir qui s’y opposera. » Si le législateur avait pris la peine d’écouter, il aurait pourtant entendu les voix de celles et ceux qui osent encore demander une politique respectueuse des droits fondamentaux et de la dignité des personnes, quels que soient leur nationalité ou leur statut administratif.
Par Prune Missoffe
Cet article est paru dans la revue Dedans Dehors n°122 – mai 2024 : Isolement carcéral « je suis dans un tombeau »
[1] Voir sur ce point Julien Fischmeister, « »Méchant avec les méchants » : la démagogie langagière à l’épreuve des faits », Plein droit, n° 138, 2023.
[2] Voir Julien Fischmeister, « Comment la « double peine » du projet de loi immigration renforce la confusion des pouvoirs », The Conversation, 14 décembre 2023 (en ligne).
[3] Voir la contribution soumise au Conseil constitutionnel par différentes associations, dont l’OIP.
[4] Arnaud Philippe et Jérôme Valette, « Immigration et délinquance : réalités et perceptions », La lettre du CEPII, n° 436, avril 2023.
[5] Audition de Gérald Darmanin devant la commission des lois du Sénat, 28 février 2023.
[6] Parmi les 91 104 personnes étrangères condamnées en 2022, 86 492 l’ont été pour des délits et 4 146 à des contraventions. Source : Ministère de la Justice, Tableaux des condamnations en 2022, Tableau 23.
[7] Ces infractions sont recensées à l’article 7 de la nouvelle loi.
[8] « Prison et titres de séjour : le règne de l’arbitraire », Dedans Dehors n° 109, décembre 2020.
[9] Contestations des obligations de quitter le territoire français notifiées en prison : pas l’ombre d’un droit, rapport de l’OIP, septembre 2017.
[10] Voir notamment Conseil d’État, no 163690, 22 janvier 1997.
[11] Protections listées à l’article L.631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda).
[12] Ou cinq ans pour les protections dites « quasi-absolues » (listées à l’article L.631-2 du Ceseda), qui ne pouvaient jusque-là être levées que dans certains cas limitatifs, notamment en cas de terrorisme ou d’atteintes aux intérêts fondamentaux de l’État.
[13] Article 131-30-2 du code pénal.
[14] « Qu’est-ce qui influence le prononcé des peines ? », entretien avec Arnaud Philippe, Dalloz actualité, 4 mars 2022.
[15] Estimation basse réalisée à partir des données de 2022 publiées par le ministère de la Justice.
[16] Audition de Gérald Darmanin devant la commission des lois de l’Assemblée nationale, 1er décembre 2023.
[17] Intervention de Nicolas Sarkozy devant l’Assemblée nationale, 3 juillet 2003.