L’administration pénitentiaire n’a de cesse de renforcer ses protocoles sur la prévention du risque suicidaire. Mais dans un environnement inévitablement suicidogène, ces mesures se heurtent à de nombreuses limites, accentuées par une surpopulation et un manque de moyens humains qui ne font que s’aggraver.
Le suicide en détention est une préoccupation majeure de la Direction de l’administration pénitentiaire (Dap), qui a adopté successivement plusieurs stratégies de prévention depuis 1967. Un vaste plan national a été élaboré en 2009, et il est régulièrement affiné depuis, dernièrement le 5 juillet 2022. Cette stratégie est également déclinée au niveau local, avec la présence de « référents suicide » au sein de chaque direction interrégionale (DI) et de chaque établissement. Le dernier plan national a été suivi de la publication d’un guide pratique, « presque des fiches-actions pour les agents », d’après Charles Barbetti, chef du département des politiques sociales et des partenariats à la Dap. Retour sur les principaux outils de cet arsenal, malgré lequel le risque de suicide reste encore dix fois plus important en prison qu’en population générale (Lire « Au quartier disciplinaire, le risque suicidaire est multiplié par vingt »).
Un repérage à trous
Le repérage des personnes détenues vulnérables est censé commencer en amont de l’incarcération. Le magistrat en charge du dossier doit remplir une notice individuelle mentionnant si des facteurs de risque suicidaire sont d’ores et déjà identifiés. Il peut également recommander une consultation médicale ou psychiatrique en urgence. L’Inspection générale des affaires sociales (Igas), dans un rapport publié en 2021[1], relève toutefois que si « les notices individuelles se sont largement généralisées, les informations ne sont pas toujours complètes et [sont] souvent superficielles, faute notamment d’informations et d’éléments à disposition des magistrats ».
La surveillance se poursuit quand la personne arrive en prison, un moment très sensible, potentiellement générateur d’un « choc carcéral ». « Nous avons une vigilance systématique à ce moment-là », confirme Geoffroy Valmy, psychiatre au service médico-psychologique régional (SMPR) de Toulouse-Seysses. Mais certains passent à travers les mailles du filet : « Le dépistage “arrivant” se fait sur la base du volontariat, il y a donc des gens qui le refusent, ce qui laisse une possibilité de passer à côté d’une évaluation », poursuit le psychiatre. À la suite d’un entretien, généralement avec un gradé, une « grille d’évaluation du potentiel suicidaire » est aussi remplie et mise en ligne sur le logiciel Genesis. Mais, selon Monsieur R., psychologue clinicien ayant travaillé au sein d’une maison centrale sécuritaire, « une fois cette fiche remplie, elle n’est pas forcément réactualisée. Même pour les personnes que l’on voit régulièrement, qui présentent des souffrances. Pourtant, tous les personnels peuvent noter des observations – surveillants, conseillers pénitentiaires d’insertion et probation (Cpip), soignants, enseignants, etc. Il y a encore quinze jours, en analysant une situation, je me suis aperçu que la dernière grille datait de cinq ans. » La Dap recommande aussi que « le chef du bâtiment et/ou son adjoint »[2] vérifient « quotidiennement » si de nouvelles observations ont été portées dans la grille, mais dans les faits, cet outil n’est pas toujours consulté (Lire Karima, un vie suspendue à un « mot-clé »).
Le repérage des comportements à risque doit ainsi faire l’objet d’une attention particulière tout au long de la détention, en particulier lors d’évènements qui exposent la personne détenue à une vulnérabilité accrue : annonce d’une mauvaise nouvelle, refus d’aménagement de peine, placement au quartier disciplinaire (QD) ou à l’isolement, approche du jugement ou de la sortie. Mais sur le terrain, la remontée des informations n’est pas toujours effective. « Les actes auto-agressifs ne nous sont pas systématiquement signalés, note Geoffroy Valmy. Nos partenaires ont du mal à déterminer si quelqu’un se fait du mal parce qu’il va mal ou parce qu’il veut quelque chose. Ils manquent de connaissances sur ce qu’il faut demander pour savoir où en sont les gens. » À l’inverse, ces difficultés de repérage peuvent mener à des signalements abusifs et un engorgement des demandes de consultation en psychiatrie.
Et si les acteurs pénitentiaires sont formés à repérer des éléments tangibles, tels que l’expression d’idées ou d’intentions suicidaires, certains comportements ou des changements d’attitude (troubles du sommeil, perte d’appétit, tristesse, etc.), ceux qui ne se manifestent pas échappent davantage à la vigilance du personnel. « Pour moi, c’est presque un signe de bonne santé mentale de dire qu’on va se suicider quand on est au QD, tant sur le plan de la santé mentale, ce n’est bon pour personne. C’est plutôt ceux qui ne disent rien qui auraient tendance à m’inquiéter », indique Pascale Giravalli, psychiatre à l’unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA) de Marseille et présidente de l’Association des secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire (ASPMP). Détenu à Bapaume, Monsieur G. abonde : « Actuellement, il y en a un qui a pris vingt ans. C’est un robot, il ne dit rien, il ne parle à personne, il fait des allées et venues dans la coursive… Pour moi, c’est un gars qui risque de passer à l’acte. »
Parmi les grands axes de la politique de prévention menée par la Dap figure justement le renforcement de la formation du personnel pénitentiaire au repérage et à l’évaluation du potentiel suicidaire. C’est dans cette optique que l’administration a diffusé en 2023 un guide de référence à destination de ses agents. La formation « Terra »[3]sur la prévention du suicide est proposée sous la forme d’une « sensibilisation » à l’École nationale d’administration pénitentiaire (Enap), puis sous sa forme intégrale en formation continue, dans les directions interrégionales et les établissements. Mais entre les murs, les connaissances se perdent vite : « L’Enap a formé énormément de personnes, et certaines ont suivi la formation trois ou quatre fois dans leur carrière, relate Monsieur D., psychologue intervenant au sein d’une école nationale. Mais si cette méthode n’est pas appliquée régulièrement, les idées reçues reviennent au bout de quelques années, sous l’effet du groupe. » Un surveillant confirme : « On nous apprend les bases, ensuite il faut les appliquer sur le terrain, mais comme il n’y a pas de suivi, ça peut vite disparaitre. » Enfin, malgré le travail de formation et de sensibilisation, certains surveillants ne s’emparent pas de la situation : « Si les collègues s’en foutent, ils se contentent de dire “Tu veux te tuer, tue-toi” et ils claquent la porte », signale une gradée en centre pénitentiaire.
Autre pilier du dispositif mis en place par l’administration pénitentiaire, des commissions pluridisciplinaires uniques (CPU) « Prévention du suicide » se tiennent deux fois par mois dans chaque établissement, réunissant le personnel pénitentiaire et d’autres intervenants en détention, notamment les soignants. Des actions à mettre en œuvre y sont décidées pour les personnes détenues présentant un risque suicidaire majeur, actions qui doivent ensuite être listées et suivies dans des plans de protection individualisés (PPI). Un document qui est cependant souvent inexistant sur le terrain, comme le constatait l’Igas en 2021.
Des carences massives en moyens humains
Plusieurs agents de l’administration pénitentiaire (AP) insistent sur la difficulté d’assurer leur mission de prévention du suicide dans l’ambiance délétère qui affecte nombre d’établissements. La surpopulation s’accompagne en effet d’un manque de personnel. « On n’est pas assez nombreux, on est fatigués, on a trop d’arrêts, témoigne un surveillant dans une maison d’arrêt dont le taux d’occupation dépasse les 200 %. On n’a pas le temps de créer du lien, de travailler la réinsertion et de prévenir les risques suicidaires, mais aussi les violences… […] J’essaie de parler avec un détenu quand j’ai cinq minutes, mais il y a des journées où je n’arrête pas. » Les carences en personnel grèvent aussi la transmission des informations. « Quand j’étais chef de détention, je recevais régulièrement un détenu angoissé quand ça n’allait pas le soir, on discutait cinq minutes. Ça a duré des mois, raconte un chef d’établissement. Et puis l’été, je suis parti en congés sans le signaler à mon remplaçant, qui a traité ce détenu comme on le faisait en général : pas de demande écrite, pas d’audience. Il a mal réagi, on l’a mis au QD, et il s’est pendu. On est tellement pris par des urgences qu’on ne se passe plus les consignes. »
Autre déficit en moyens humains, celui du secteur de la psychiatrie et des médecins généralistes. Les soignants – touchés par la crise qui traverse le secteur hospitalier, et dont les effectifs sont calculés sur le taux d’occupation théorique des établissements – sont en nombre insuffisant pour assurer la prise en charge et le suivi de toutes les personnes détenues en ayant besoin. Le problème est aggravé par le manque d’attractivité des postes en détention, comme le montrait l’OIP dans un rapport publié en 2022– un sujet sur lequel la Dap indique travailler avec la Direction générale de l’offre de soins (DGOS). « Dans notre centre pénitentiaire, il y a un psychiatre, une psychologue et des infirmiers psy, pour plus de 700 détenus. L’unité sanitaire est débordée, elle gère l’urgence », relate une surveillante. Les consultations sont souvent brèves, quand les personnes détenues arrivent à obtenir un rendez-vous : « L’autre jour, j’avais rendez-vous à 10h45, on était dix dans la salle d’attente et tout le monde avait rendez-vous à 10h45. On n’a pas le temps de parler au médecin, c’est du travail à la chaîne », explique une personne détenue à Bapaume. Les places en UHSA sont chères pour les hospitalisations à la demande des personnes détenues en souffrance[4] : « En soins libres, nos délais de prise en charge varient entre trois et quatre semaines », atteste Thomas Fovet, psychiatre à l’UHSA de Lille-Seclin.
Or, le nombre de personnes détenues présentant des troubles psychiatriques graves est en augmentation[5]. Et faute d’une alternative à l’incarcération adéquate, l’Igas relève que « quand un risque suicidaire est fortement suspecté […], le magistrat […] transfère à l’AP la responsabilité, par [la] notice individuelle, de trouver des solutions adaptées ». Il ne relève pourtant pas non plus des fonctions des agents pénitentiaires de faire face à de tels profils. Une surveillante commente : « Nous rencontrons de plus en plus de problèmes psychiatriques. L’année dernière, on est passé de 65 à 80 % de détenus présentant des troubles psychiatriques sur la direction interrégionale de Lyon. En juillet 2024, on nous a parlé d’une explosion du nombre de suicides dans la DI. On n’a aucune explication, on se débrouille, c’est une gestion à l’arrache. » Un autre abonde : « Il faut que les juges arrêtent de nous envoyer des cas qui n’ont rien à faire chez nous. » Si depuis mars 2019, la suspension de peine pour raison médicale est théoriquement possible pour les personnes admises en soins psychiatriques sans leur consentement, la mesure se heurte à de tels écueils qu’elle est très peu mobilisée.
Enfin, aux problèmes d’effectifs s’ajoutent des relations plus ou moins fluides entre le personnel pénitentiaire et le personnel soignant. « Globalement, un tiers des soignants participe aux CPU “Prévention du suicide” », indique Laurent Trippier, chef du pôle Santé de la Dap. Outre le fait que les soignants n’ont pas toujours le temps, la question du secret médical est au cœur des débats, et tout dépend du lien de confiance noué entre la pénitentiaire et le corps médical. « Depuis qu’on a imposé la traçabilité, les médecins ont dit qu’ils ne viendraient plus aux CPU, confie un chef d’établissement. Ça n’existe pas, le secret partagé. Donc ici, les médecins viennent ou pas, et on les appelle quand on est préoccupé, de façon informelle. Si on veut un partenariat de qualité, on est obligé de se cacher. » La proximité des relations peut aussi dépendre de la taille de l’établissement. Un surveillant explique : « Ici, c’est une petite maison d’arrêt, donc on peut échanger avec le personnel médical. Par contre, à Lyon par exemple, c’est tellement grand que chacun est dans sa zone. »
Une lutte contre l’isolement limitée
Dans certains établissements, on permet aux personnes chez lesquelles on pense déceler un risque suicidaire d’accéder à davantage de sociabilité et d’occuper leur temps, et leur esprit : « Ici, ça se passe bien grâce au travail de la cheffe de détention, elle connaît les plus vulnérables, elle les oriente vers le scolaire, vers le travail, elle cherche à les sortir de là », indique une gradée du sud-est de la France. Mais cela ne fait pas l’objet de recommandations particulières au niveau national. « On essaie de développer notre offre d’activités de manière générale. Si on ne fait pas de proposition d’activités spécifique aux personnes détenues à risque suicidaire, cela leur bénéficie par définition », avance Sandrine Rossi, adjointe au sous-directeur de l’insertion et de la probation à la Dap. « Une énorme partie des activités mises en place par mon département, du maintien des liens familiaux jusqu’au sport, peut avoir un impact en termes de prévention du suicide », abonde son collègue Charles Barbetti.
D’autres ressources sont accessibles aux personnes détenues, comme des numéros de téléphonie sociale, tels que Croix-Rouge Écoute. L’accès au 3114, numéro national de prévention du suicide, est testé depuis octobre 2024 à la maison d’arrêt d’Angers, avant de l’être dans quatre autres prisons (Brest, Poitiers-Vivonne, Uzerche et Rouen) d’ici janvier 2025. La Dap prévoit d’évaluer le dispositif à la mi-2025 avant d’envisager, le cas échéant, une généralisation à tous les établissements.
L’administration développe aussi depuis 2014 le dispositif des codétenus de soutien (CDS). Il s’agit de mobiliser des personnes détenues volontaires comme acteurs de la prévention du suicide dans leur établissement. Recrutés par les équipes de direction, elles reçoivent une courte formation, dispensée par la Croix-Rouge française et l’Union nationale des professionnels de santé (UNPS). Auparavant limité aux établissements de plus de 600 places, le recours aux CDS peut désormais être organisé dans tout type d’établissement. D’après la Dap, c’est le cas dans 23 prisons actuellement. Toutefois, la responsabilité morale du CDS auprès de la personne détenue qu’il accompagne est lourde, et peut entraîner des répercussions psychologiques importantes sur lui, particulièrement en cas de passage à l’acte.
« On a toujours des détenus qui préviennent qu’un autre va mal, sans avoir à désigner des codétenus de soutien, nuance un chef d’établissement. Les détenus ne sont pas indifférents à ce que vivent leurs codétenus, il y a des formes de solidarité. » Mais ces détenus impliqués se sentent parfois bien seuls : « Une fois, j’ai convaincu quelqu’un qui voulait se pendre de ne pas le faire, témoigne l’un d’eux. Je suis allé le voir tous les jours, le temps que ça se calme. J’en ai parlé aux surveillants, mais ils s’en foutaient, rien n’a été fait. Chaque jour, je lui demandais : “Tu as vu quelqu’un ?” Mais non, il ne voyait personne. »
Le bât blesse particulièrement sur les mesures de lutte contre l’isolement au QD, haut lieu de passage à l’acte suicidaire(9). Les textes prévoient un entretien avec un personnel d’encadrement à l’arrivée pour déceler une éventuelle fragilité, l’accès au téléphone et la mise à disposition d’un poste de radio en cellule. Mais en réalité, les appels des personnes détenues sont limités à un par semaine, et celles qui ont accès à la radio, quand elle fonctionne, n’ont pas toujours le choix de la station écoutée. La Dap préconise également deux sorties en promenade par jour, mais les cours de QD se limitent bien souvent à quatre murs assortis de grillages et de caillebottis obstruant la vue du ciel, sans banc ni agrès.
Quant à l’accès aux soins, il est particulièrement entravé au QD. Outre de très brèves visites bi-hebdomadaires effectuées par l’unité sanitaire à travers la grille du sas d’entrée des cellules, les psychiatres, quand ils sont sollicités, se heurtent à des obstacles sécuritaires pour effectuer leur consultation. « Le QD est l’endroit le plus sensible sur le plan du risque suicidaire, mais nous ne pouvons pas y déployer nos moyens, alors qu’ils mériteraient justement d’être accrus. Pour travailler, on a besoin d’un plateau technique, de notre équipe, d’un bureau, d’accès au dossier médical. Mais là, on nous demande d’évaluer le potentiel suicidaire dans une salle qui sert aux appels téléphoniques, aux parloirs avocats, un peu à tout, dénonce Geoffroy Valmy. On jetterait une pièce pour voir de quel côté ça tombe, franchement, ce serait pareil. »
Un contexte délétère
« Ceux qui sont dans le bateau font ce qu’ils peuvent. Mais le contexte est insécurisant, aggravé par la surpopulation carcérale qui est un problème majeur de santé public, résume la psychiatre Pascale Giravalli. Les dispositifs reposent vraiment sur les personnes. C’est ce qui est épuisant, et pousse pas mal de soignants à quitter le milieu pénitentiaire. » L’ampleur des souffrances à prendre en charge et le manque de moyens réellement adaptés peuvent en effet nourrir un sentiment d’impuissance chez bon nombre d’intervenants. Voire l’impression de cocher des cases à seule fin de protéger l’administration : « On nous demande une traçabilité totale, pour qu’on puisse dire qu’on a tout fait pour l’empêcher, s’agace un chef d’établissement. Il y a tout un formalisme autour de la prévention du suicide, et j’ai le sentiment que l’AP ne tourne qu’autour de ça. On ne prend pas en compte l’histoire des détenus, on ne nous demande pas comment vont les familles et nous, mais on nous met la pression pour qu’on applique à la lettre les plans de prévention. »
Et pourtant, malgré un déploiement toujours plus large, le protocole échoue encore à éviter de trop nombreux passages à l’acte. En cause, les failles dont souffrent chacune de ces mesures. Mais aussi, et surtout, l’absence d’une véritable volonté politique de s’attaquer aux problèmes structurels de la prison, tels que les conditions de détention, la surpopulation et l’accès aux soins, dans un environnement qui reste, et restera, particulièrement suicidogène.
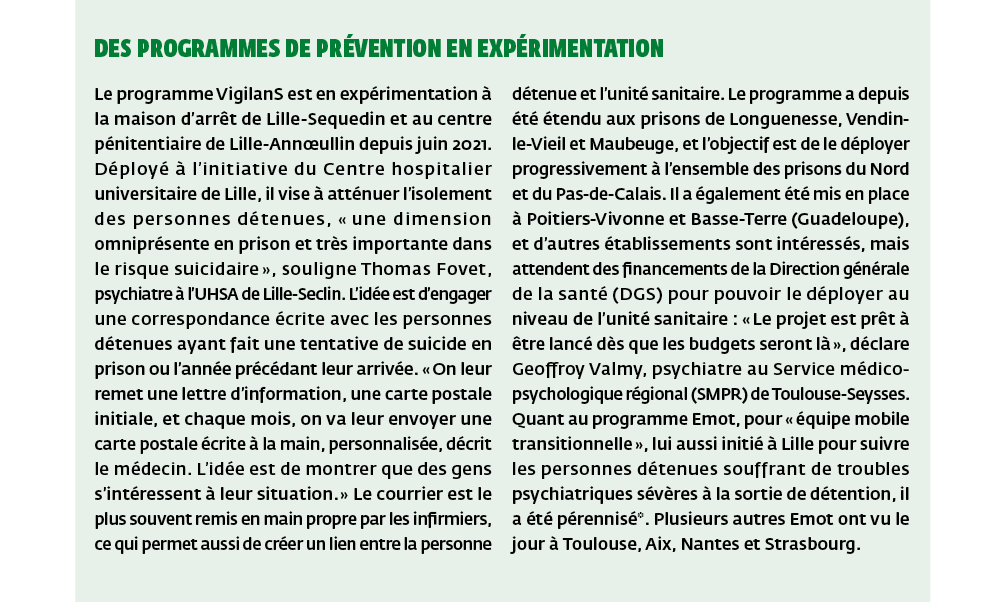
Cet article a été publié dans le Dedans Dehors N°124 : Dix fois plus de suicides en prison qu’à l’extérieur
Par Pauline Petitot
[1] IgasIGJ, Rapport sur la prévention du risque suicidaire en milieu carcéral, mai 2021
[2] DAP, pratiques professionnelles : la prévention du suicide en milieu carcéral, 2023
[3] Du nom de son fondateur, le psychiatre Jean-Louis Terra
[4] En revanche en cas de crise suicidaire aigüe, le détenu est censé être hospitalisé en urgence. Dans l’attente, il fait souvent l’objet de deux mesures pénitentiaires, la dotation de protection d’urgence (DPU) et/ou la mise en cellule de protection d’urgence (CProU)
[5] Thomas Fovet et Camille Lancelevée, la prison pour asile ?, Éditions de la Maison des sciences de l’Homme, avril 2024






